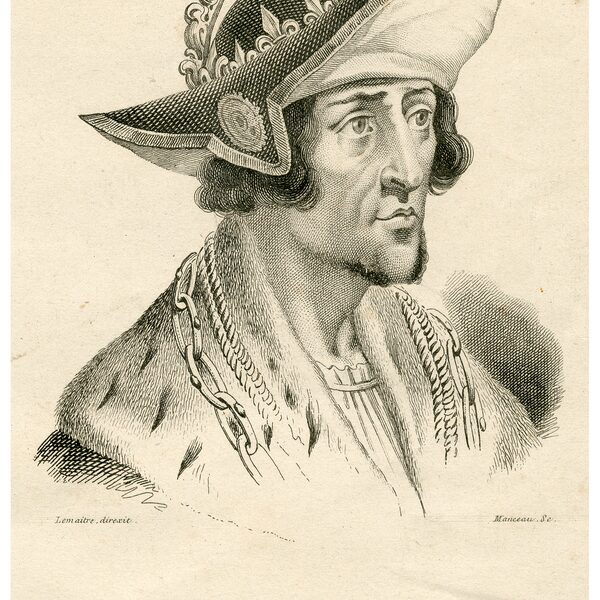Wiesbaden sous la domination de Nassau
La lignée des comtes de Nassau remonte aux comtes de Laurenburg et était apparentée aux familles nobles de la région de la Lahn et du Westerwald. Au 12ème siècle, le centre du pouvoir se trouvait sur la Lahn moyenne, où les Laurenburg ont construit le château de Nassau peu après 1100. Les Nassau ont connu une ascension rapide à l'époque des Hohenstaufen, lorsqu'ils se sont distingués au service de l'Empire. C'est sans doute à cette proximité avec le roi qu'ils doivent l'octroi de biens impériaux dans la région de Wiesbaden au cours des 12ème et 13ème siècles. Lors d'un premier grand partage en 1255, le comte Walram reçut les biens au sud de la Lahn, tandis que le comte Otto obtint des terres au nord du fleuve. Le traité de partage est muet sur Wiesbaden, mais il semble que la lignée Walram ait été en possession de la ville depuis les années soixante-dix du 13ème siècle. En 1292, le comte Adolf, qui fut élu roi la même année, désigna Wiesbaden comme "oppidum nostrum" (notre ville).
En fait, Wiesbaden était depuis lors sous la souveraineté des Nassau et assumait au Moyen-Âge une certaine fonction d'avant-poste contre les revendications territoriales de ses voisins, en premier lieu les seigneurs d'Eppstein et l'archevêché de Mayence. La fondation du monastère de Klarenthal par le comte Adolf en 1298, qui devint le monastère de la maison et le lieu de sépulture d'une partie des comtes de la branche walramienne, en est la preuve.
Le lien avec la maison de Nassau a déterminé l'histoire de Wiesbaden jusqu'à l'époque moderne. En 1480, le comte Adolf III (1480-1511) obtint Wiesbaden, qui devint ainsi pour la première fois la résidence d'une partie indépendante du Land. Sous la régence du comte Philippe II, l'ancien seigneur (1511-1558), la révolte des paysans du Rheingau s'étendit à Wiesbaden, ce à quoi le seigneur de la ville répondit par des sanctions draconiennes. Son fils Philipp III, le jeune seigneur (1558-1566), introduisit la Réforme. Selon le contrat du 27 décembre 1554 avec ses frères Adolf IV et Balthasar, qui appartenait à l'Ordre Teutonique, il devait recevoir Wiesbaden à la mort de son père.
Comme Adolf IV mourut en 1556 et qu'il resta lui-même sans héritier légitime, Philippe céda dès 1564, deux ans avant sa mort, Idstein à son frère Balthasar, qui quitta en échange l'Ordre Teutonique. Après la mort de Philippe en 1566, ce dernier reprit également la seigneurie de Wiesbaden. En 1599 et 1605, la lignée Wiesbaden-Idstein s'éteignit en tant que mâle. L'héritage revint à la lignée Nassau-Saarbrücken-Weilburg. Le comte Louis II réunit ainsi pour la première fois depuis le partage de 1355 toutes les possessions walramiennes en une seule main.
La mort de Louis en 1627, dans une phase décisive de la guerre de Trente Ans, plongea les comtés de Walram dans une grave crise. Ses quatre fils décidèrent de procéder à un nouveau partage et choisirent chacun un comté lors de la signature du traité en 1629. Le comte Johannes (1627-1677) opta pour le comté d'Idstein avec les seigneuries de Wiesbaden, Sonnenberg, Wehen et Burgschwalbach. En 1635, ses territoires furent occupés et confisqués et en partie vendus à des acolytes de l'empereur. Le territoire du comté de Nassau-Idstein fut divisé. La seigneurie d'Idstein fut attribuée au prince Schwarzenberg, la seigneurie de Wiesbaden fut formellement remise au prince électeur de Mayence le 07.03.1637. Grâce à l'amnistie impériale, le comte Johannes von Nassau-Idstein entra à nouveau en possession de l'ensemble du comté en 1647.
Entre Johannes et son dernier frère encore en vie, Ernst Kasimir, ainsi que les trois fils de son frère Wilhelm Ludwig, un différend successoral s'éleva, qui fut réglé par le récépissé de Gotha du 06.03.1651. Le comte Johannes se vit attribuer les seigneuries d'Idstein et de Wiesbaden avec la cave de Sonnenberg, le Wehener Grund, l'office de Burgschwalbach, la part idsteinienne de l'office de Nassau et la seigneurie de Lahr. Ernst Kasimir reçut la seigneurie de Weilburg et ses dépendances. Les fils du défunt comte Wilhelm Ludwig se partagèrent leurs biens en 1659. Les lignées d'Ottweiler, de Sarrebruck et d'Usingen furent créées. Les relations entre les maisons devinrent de plus en plus difficiles au cours des décennies suivantes, car les régents respectifs décédaient généralement en bas âge et les tutelles mises en place percevaient leurs propres avantages.
Les dispositions du récépissé de Gotha sur les paiements compensatoires à effectuer entre eux étaient également très explosives. Les querelles portent également sur les intérêts de l'État, les fiefs impériaux, la réduction des dettes, les questions de droit successoral et l'élévation au rang de prince impérial. C'est surtout le prince Georg August Samuel zu Nassau-Idstein (1677-1721) et son cousin Walrad von Nassau-Usingen qui s'engagèrent en faveur d'une élévation de statut, malgré la résistance des lignées de Sarrebruck et de Weilbourg. L'élévation au rang de prince impérial en 1688 déclencha une querelle de préséance entre les lignées walramiennes, qui fut réglée devant le Conseil de la Cour impériale. Celui-ci accorda certes la prééminence à Georg August Samuel en 1714, mais les parents refusèrent la reconnaissance et les paiements compensatoires qui en découlaient. Les lignées d'Ottweiler, de Sarrebruck, de Weilburg et d'Usingen ont convenu dans le traité de Francfort de 1714 qu'à la mort de Georg August zu Nassau-Idstein, qui n'avait pas de fils, ses biens leur reviendraient. Lorsque ce cas se présenta en 1721, Nassau-Ottweiler et Nassau-Saarbrücken prirent possession des possessions idsteiniennes. Le comte Friedrich Ludwig zu Nassau-Ottweiler régna sur Nassau-Idstein et donc aussi sur la ville de Wiesbaden jusqu'en 1728. A sa mort, l'héritage revint à la lignée Nassau-Usingen, où la princesse douairière Charlotte Amalie de la lignée Nassau-Dillenburg exerça la tutelle sur ses fils Karl et Wilhelm Heinrich.
Comme les lignées ottoniennes étaient également impliquées à cette époque dans des querelles d'héritage, un contrat de maison fut conclu le 25/30 mai 1736, qui est considéré comme la base de tous les contrats de maison de Nassau ultérieurs. Les deux tribus s'y assuraient une succession mutuelle en cas d'extinction. Charlotte Amalie zu Nassau-Usingen procéda en 1735 à un partage de l'héritage selon lequel son fils Karl (1712-1775) reçut les possessions de la rive droite du Rhin avec Usingen, Idstein et Wiesbaden, son frère cadet Wilhelm Heinrich (1718-1768) toutes les possessions de la rive gauche du Rhin. Nassau-Usingen introduisit la primogéniture en 1754, Nassau-Sarrebruck en 1768. Dans l'accord successoral de 1783, ces deux branches de Nassau s'assurèrent mutuellement l'héritage.
La lignée de Sarrebruck s'éteignit en 1799 avec le prince Henri, la France ayant déjà occupé les possessions de Nassau sur la rive gauche du Rhin. La lignée d'Usingen, qui régnait à Wiesbaden, obtint la dignité de duc en 1806, mais s'éteignit en 1816 avec le prince Friedrich August. La même année, la lignée Nassau-Weilburg lui succéda dans le duché. Le duc Wilhelm et son fils Adolph zu Nassau ont dirigé le destin du duché de Nassau jusqu'à son annexion par le royaume de Prusse en 1866.
Littérature
Bleymehl-Eiler, Martina : Stadt und frühneuzeitlicher Fürstenstaat : Wiesbadens Weg von der Amtsstadt zur Hauptstadt des Fürstentums Nassau-Usingen (Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts), 2 Bde., thèse de doctorat non imprimée, Mayence 1998.
Even, Pierre : Dynastie Luxembourg-Nassau. Des comtes de Nassau aux grands-ducs de Luxembourg. Une histoire de souveraineté de neuf cents ans en cent biographies, Luxembourg 2000.